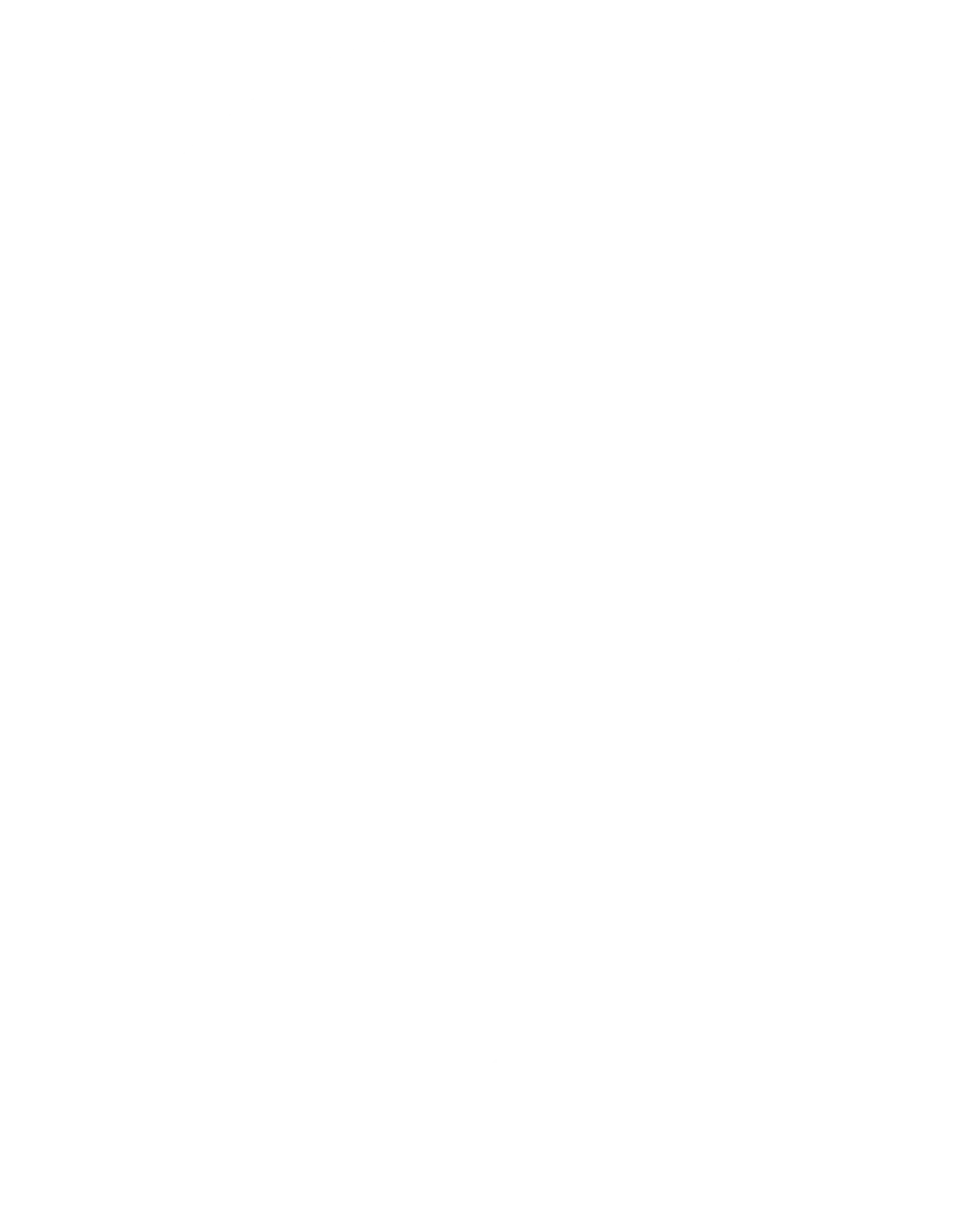« Comme si » : voilà la formule magique. Le droit parle toujours au conditionnel de l’imaginaire. Comme si l’argent pouvait consoler l’inconsolable. Comme si une société commerciale avait une âme. Comme si un individu brisé restait identique à lui-même. Le droit avance ainsi dans le monde, non pas en cherchant la vérité, ce n’est pas sa vocation, mais en inventant des vérités opératoires, des vérités d’institution.
Mais lorsque cette mécanique rencontre la chair blessée, l’édifice tremble. Le traumatisme crânien est exemplaire. Dans la chambre d’hôpital, dans le quotidien d’un foyer, c’est l’évidence : le sujet est métamorphosé. Sa mémoire n’est plus qu’une mosaïque ébréchée, ses émotions se déchaînent comme des bêtes imprévisibles, sa volonté vacille. Son entourage le dit avec une lucidité cruelle : « ce n’est plus lui ».
Or le droit refuse cette mutation. Il s’arc-boute sur la permanence. Il proclame : « il demeure le même sujet de droit », car son système ne connaît pas d’autre langage.
Que l’identité humaine se joue dans la tension entre la permanence et la promesse, entre ce qui reste et ce qui se transforme.
Mais le droit, lui, n’admet que l’idem : il fige l’individu, il le fixe comme un bloc, même si sa vie intérieure s’est effondrée.
Le droit écrit, décrète, statue, mais son écriture est déjà un voile : une tentative d’arrêter ce qui, par essence, se dérobe. La cicatrice invisible du crâne fêlé devient alors le lieu d’une discordance radicale : la personne vécue s’échappe de la personne juridique.
C’est peut-être là que la poésie affleure, malgré tout. Car il y a quelque chose d’admirable et de terrible dans ce mensonge nécessaire.
Sans fiction, le droit s’effondrerait : il n’y aurait plus de continuité, plus de responsabilité, plus de langage commun pour dire la blessure et tenter de la compenser. Mais à force de maintenir cette fiction, il en vient à masquer le tragique de l’existence.
L’avocat, dans son office, ne se contente pas de chiffres et de barèmes. Il prend les colonnes comptables, les taux d’incapacité, et cherche à les fissurer pour y faire passer une voix, une histoire, une chair. Derrière les équations froides, il rappelle qu’il y a un être qui tâtonne pour retrouver son nom, un être qui sait qu’une part de lui s’est effondrée à jamais. Le droit proclame : « réparation intégrale ». Mais l’avocat s’efforce de montrer que ce mot sonne creux, que la vérité intime n’est pas une ligne de calcul mais un cri : « irréparable ».
Ainsi la fiction juridique apparaît pour ce qu’elle est : une mise en scène du décalage entre nos vies et l’ordre que nous voulons leur imposer. Elle n’est pas seulement un outil technique, elle est la tragédie constitutive du droit. Comme le masque grec, elle ne révèle qu’en dissimulant. Elle nous rappelle que la justice humaine n’est pas affaire de vérité, mais de croyances partagées.
Dans le cas du « crâne fêlé », cette croyance prend la forme paradoxale d’un serment collectif : continuer à affirmer qu’il est le même, alors même que tout, dans sa chair, dit qu’il est autre. C’est là le prix à payer pour que le droit demeure possible. Mais ce prix, souvent, se paie dans le silence du patient et la détresse de ses proches.
LA RÉPARATION QUI N’EN EST PAS UNE
On appelle cela la réparation intégrale. L’expression résonne comme un verdict définitif, une promesse d’achèvement. Mais c’est un mot trop grand pour un geste trop court. Le juge additionne, l’assureur calcule, l’avocat plaide. Le rite se déroule avec la précision d’une horloge : barèmes, expertises, tableaux. Et au bout du compte, une somme surgit, un chiffre froid censé recouvrir l’abîme.
Mais ce qu’il prétend réparer, c’est l’irréparable. Comment l’arithmétique pourrait-elle combler la perte d’une mémoire trouée, d’un amour fragilisé par la colère et la fatigue, d’un regard devenu étranger ? Camus rappelait que le tragique naît de ce décalage entre notre soif de sens et le silence du monde. Ici, le tragique prend la forme du droit : l’écart entre la promesse d’intégralité et la réalité d’un être disloqué.
Toute culture vit de fictions nécessaires. Le droit est l’une d’elles, peut-être la plus vitale, parce qu’il ordonne le chaos. Mais comme toute fiction, il ment et parfois, ce mensonge a la dureté d’une lame. On dit « réparation », on proclame « justice », mais derrière ces mots s’avance le nihilisme de la monnaie : tout devient chiffre, tout se réduit à équivalent.
Ce processus est une technologie du pouvoir. La blessure invisible n’échappe pas à la grille normative : elle est captée, traduite, disciplinée par les dispositifs médico-légaux. On mesure la perte en pourcentages, on normalise l’invisible, on soumet la douleur à la bureaucratie des barèmes. La souffrance devient dossier. La cicatrice invisible se transforme en ligne de compte.
Kafka, dans une de ses paraboles, aurait pu décrire le blessé comme cet homme arrêté devant une porte de justice qui ne s’ouvre jamais vraiment. Le procès s’accomplit, les procédures s’enchaînent, le jugement tombe. Mais ce qu’il attendait — une reconnaissance absolue, une guérison symbolique — ne viendra jamais. La réparation intégrale, c’est cette porte toujours entrebâillée, qui laisse passer la lumière d’une promesse mais ne livre jamais l’accès au vrai soulagement.
Quand le droit affirme que l’individu blessé « demeure le même sujet de droit », il refuse paradoxalement son altérité nouvelle, celle qui surgit de la blessure. Il le fige dans une identité abstraite, quand tout, dans son être, a changé. Il trahit ce visage qui demande non pas des chiffres, mais une écoute.
Alors oui, la réparation n’en est pas une. Elle est une fiction sociale, une liturgie du mensonge partagé, une manière de conjurer le chaos par des équations froides. Comme une messe laïque, elle récite ses formules pour maintenir la cohésion du groupe, pour éviter que nous soyons confrontés de plein fouet à l’abîme de l’irréparable.
Le droit fait semblant… il doit faire semblant. Mais ce semblant, parfois, écrase ceux qu’il prétend protéger. Sous le masque grec de la « réparation intégrale », il y a des cicatrices que nulle somme ne saura jamais apaiser. Et c’est peut-être là, dans cet écart béant entre le langage et la chair, que réside le cœur tragique de notre condition : nous ne savons vivre qu’en fictions, mais ces fictions nous rappellent sans cesse que la vérité est ailleurs, dans la douleur, dans le silence, dans ce qui ne se répare pas.
L’OBJECTIVITÉ EN TROMPE-L’ŒIL
L’expert ausculte, mesure, interroge. Les tests s’enchaînent comme des énigmes : normaux, subnormaux, inclassables. Le scanner ne dit rien, l’IRM se tait. Le corps apparaît transparent à la machine, mais opaque à lui-même. Et pourtant, le droit s’y accroche comme à un oracle : « ce qui est écrit dans le rapport est la vérité ». Le papier devient loi, la conclusion devient certitude.
Mais dans les traumatismes crâniens, la vérité échappe aux machines. Elle se cache ailleurs : dans la lassitude du matin qui colle au corps comme une gangue, dans les gestes oubliés qu’on croit accomplis mais qui s’effacent, dans le regard qui se perd au milieu d’une conversation. Elle se niche dans la brisure discrète du quotidien.
Il faut garder à l’esprit que l’homme n’est pas seulement un être mesurable, mais un être d’apparition et de récit. Ce que les rapports taisent, ce que les chiffres ignorent, c’est la singularité de l’existence qui se déploie malgré la blessure, mais sous une forme altérée. En réduisant la personne à des indices objectivés, on nie ce qu’elle a d’irréductible : son histoire, son monde, son souffle.
Pascal, déjà, nous mettait en garde contre l’illusion de la raison pure : « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Ici, vérité dans le rapport, erreur dans la vie vécue. L’objectivité n’est qu’un trompe-l’œil, une mise en scène destinée à rassurer ceux qui jugent, non pas celui qui souffre.
La souffrance, lorsqu’elle est traduite en chiffres et barèmes, perd sa profondeur, sa singularité, son éclat propre. Elle devient donnée administrative, sans épaisseur, sans voix. Et l’homme blessé, lui, se voit renvoyé à cette version bureaucratique de lui-même, comme à un double sans âme.
Celan enfin, poète des abîmes, nous aurait rappelé que certaines vérités ne se disent qu’à travers des éclats de silence, des fragments obscurs. Le traumatisé crânien vit dans cet espace-là : ni le langage médical ni le langage juridique ne peuvent dire son épreuve. Le seul témoignage fidèle serait peut-être une poésie brisée, une parole qui boite.
Ainsi, derrière l’objectivité proclamée se cache une fiction lourde : celle d’un monde où tout serait visible, mesurable, transparent. Mais cette fiction, lorsqu’elle se heurte au crâne fêlé, devient piège. Elle écrase la voix de la victime sous la tyrannie de la preuve scientifique. Elle substitue à la nuit intérieure des chiffres lumineux, mais trompeurs.
Le droit, une fois de plus, choisit la certitude au détriment de la vérité. Et cette certitude, qui se voulait réconfort, devient masque : un masque grec posé sur un visage qui vacille, une figure d’objectivité qui cache mal la tragédie de l’existence blessée.
LE SUJET FISSURÉ
Le droit repose sur une idée simple, presque enfantine : il y aurait un sujet stable, une personne qui persiste dans le temps, identique à elle-même malgré les secousses de l’existence. C’est cette continuité qui permet d’attribuer un droit, une faute, une réparation. Mais le traumatisme crânien vient fêler cette certitude.
Celui qui se relève d’un tel choc n’est plus tout à fait celui d’avant. Sa mémoire se délite comme des pages arrachées, ses émotions surgissent avec la violence d’un orage imprévu, sa volonté se dérobe. Ce n’est pas seulement sa conscience qui se brouille, c’est son monde tout entier qui se déplace. Et autour de lui, ses proches le disent avec des mots simples, parfois cruels : « il a changé ».
Le droit, pourtant, ne peut rien entendre de cela. Il s’arc-boute sur son postulat : celui d’avant et celui d’après sont un seul et même homme. Il le faut bien, sinon tout se défait — la responsabilité, la réparation, la continuité des contrats, la stabilité de l’ordre social. Alors il décrète la permanence, quand la vie, elle, n’offre que des discontinuités.
Mais cette discontinuité n’est pas un accident. Elle est au cœur même de l’expérience humaine. Nous sommes tous traversés par des métamorphoses silencieuses, jamais identiques à nous-mêmes d’un âge à l’autre, parfois même d’un jour à l’autre. Le traumatisme ne fait que rendre brutalement visible ce que nous cachons d’ordinaire : l’éclatement intérieur de l’identité.
Face à cela, le droit choisit de fermer les yeux. Il impose le masque d’une continuité abstraite, comme on poserait un pansement trop serré sur une plaie béante. Sous ce masque, l’être fissuré peine à se reconnaître. Il doit répondre d’un nom qui n’est plus tout à fait le sien, incarner une identité qu’il ne sent plus.
Il y a là une forme de tragédie muette : pour sauver sa cohérence, le droit sacrifie une part de vérité. Il proclame que le sujet est un, indivisible, quand l’existence nous dit qu’il est toujours multiple, changeant, fragile. Et dans cet écart béant entre la fiction et la vie, c’est souvent le blessé qui porte le poids du mensonge nécessaire.
LA FICTION COMME FRAGILE HUMANITÉ
On reproche souvent au droit sa froideur, son langage de pierre, sa mécanique implacable. Mais il faut aussi voir ce qu’il tente, maladroitement : donner une forme à ce qui échappe, offrir un cadre là où il n’y a que chaos. La fiction n’est pas seulement un mensonge, elle est aussi une manière de tenir debout face à l’insoutenable. Elle ne guérit pas, mais elle empêche que tout s’effondre. Refuge bancal, certes, mais refuge quand même. Sans elle, il ne resterait que le silence, l’oubli, l’indifférence.
Car le droit n’invente pas des fictions par pur goût de l’artifice, il les invente pour rendre visible l’invisible. Il sait bien que l’argent n’apaise pas la perte, que le rapport médical ne dit pas la vérité de la douleur, que l’identité ne reste jamais intacte après l’épreuve. Pourtant il persiste, parce qu’il faut bien dire quelque chose, écrire une phrase, signer un jugement. Faute de mieux, il choisit de croire, et de faire croire.
Mais peut-être viendra un temps où une autre fiction s’inventera. Non plus celle de l’équivalent monétaire qui prétend panser les plaies, non plus celle de l’identité figée qu’on maintient coûte que coûte, mais une fiction qui sache accueillir l’expérience intime. Une fiction qui écoute la voix fragile de celui dont la vie a basculé dans la nuit, qui lui offre non seulement une reconnaissance abstraite, mais une dignité tangible.
Car la vérité du traumatisme crânien, c’est qu’il ne se voit pas. À l’extérieur, rien ou presque, mais à l’intérieur c’est une tempête. Ce qui ne se voit pas risque toujours de disparaître dans l’angle mort de nos institutions.
L’invisible, pour exister, doit être raconté.
C’est peut-être là, au fond, la tâche la plus haute du droit : inventer des fictions qui ne trahissent pas, mais qui portent.